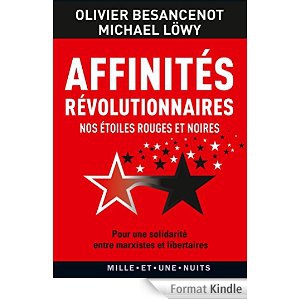Quelques réflexions à propos de : Olivier Besancenot, Michael Löwy, Affinités révolutionnaires. Nos étoiles rouges et noires. Pour une solidarité entre marxistes et libertaires, Fayard, Mille et une nuits, août 2014.
Ça ressemble à une déclaration d’amour. C’est un nouveau petit livre rouge (et noir) dans lequel le sociologue et philosophe Michael Löwy et le candidat de la Ligue communiste révolutionnaire (devenue depuis NPA) à la présidence de la République en 2002 et 2007 disent tout le bien qu’ils pensent des libertaires.
Nos étoiles rouges et noires… ça fait un peu bling, bling, trop beau pour être honnête, comme la lettre que le jeune facteur (de moins en moins jeune en fait) écrit à Louise Michel dans cet opus. Une fois de plus (1), des marxistes, léninistes, trotskystes… s’attribuent un héritage qui n’est pas le leur, mais celui de leurs voisins. Des voisins eux-mêmes affaiblis, absorbés par leurs problèmes et qui pourraient se laisser faire.
Cet ouvrage prend d’une certaine manière, quarante ans plus tard, le contre-pied du livre de Jacques Duclos Bakounine et Marx ombre et lumière (2), dans lequel le dirigeant du parti communiste français de l’époque tentait d’affaiblir l’anarchisme en dénigrant et calomniant Bakounine.
Dans le livre de Besancenot et Löwy, par contre, c’est l’anarchisme qui est mis en lumière alors que le marxisme apparaît plutôt comme la face sombre du socialisme : un mal nécessaire. Il ne s’agit pas, pour les auteurs de renier leur doctrine (le marxisme), mais au contraire de l’éclairer, de lui donner un supplément d’âme en quelque sorte, grâce à des idées et des militant-e-s libertaires.
Dans la première partie, comme dans la troisième, le texte est décoré par les portraits d’illustres ancêtres marxistes, anarchistes, ou « marxistes libertaires » qui sont offerts à l’admiration des lecteurs.
Les staliniens ou les maoïstes pour qui le marxisme était la religion d’Etat, ne sont visiblement pas des marxistes « authentiques » pour Besancenot et Löwy. Par contre, Pierre Monatte qui « préférait se définir comme « syndicaliste communiste » » aurait été « le plus marxiste des libertaires » avant 1914, pour devenir « après le premier conflit mondial, le plus libertaire des marxistes ». Celui qui ne se réclame pas du marxisme, l’est en quelque sorte malgré lui. Autre cas de figure : il y a celui qui a pu se réclamer de l’anarchie et du marxisme à un moment donné, comme Walter Benjamin, mais dont la pensée complexe et foisonnante ne peut être enfermée dans un moule… Par là se précise le propos des auteurs : il s’agit pour eux de se dissocier des principaux avatars du marxisme-léninisme et de mettre en avant des figures riches, attrayantes et positives, pour cautionner un projet politique et organisationnel réducteur.
Et les portraits se succèdent, de marxistes reconnus, comme Rosa Luxembourg et de non-marxistes, joyeusement adoptés, tels que les anarchistes Emma Goldman ou Buenaventura Durruti entre autres. Celui qui n’est pas initié, découvre ainsi, au fil des pages, que les « marxistes » sont ceux dont les auteurs s’estiment les héritiers (les militants du POUM en Espagne, par exemple) et que d’autres personnes qui n’ont jamais été marxistes méritent de voir leur portrait figurer dans cet album, parce que des trotskystes (ou Trotsky lui-même) les apprécient et/ou citent leurs propos.
On ne trouve pas dans ce livre une définition explicite du marxisme, mais à sa place, beaucoup de confusion. On lit dans les premières pages que, lors des événements de la Commune de Paris en 1871, Marx aurait écrit des textes plus libertaires que Bakounine. « Enthousiasme libertaire » de Marx qui, visiblement, fut de courte durée, puisque Bakounine et James Guillaumes furent expulsés de la Première Internationale, l’année suivante, parce qu’ils rejetaient le centralisme marxiste et refusaient d’admettre que « la conquête du pouvoir politique [soit] le grand devoir du prolétariat » (3).
Par touches successives, tout au long du bouquin, un imaginaire se met en place dans lequel le marxisme, aussi appelé « matérialisme historique » apparaît comme le pôle de la sobriété, de la rigueur, de la science, alors que l’anarchisme serait le pôle de la spontanéité, de la révolte, de la créativité, du romantisme…
A propos du syndicalisme révolutionnaire
La première partie intitulée Convergences solidaires répertorie les moments historiques où les destins des marxistes et des libertaires se seraient mêlés, depuis la Première Internationale jusqu’aux mouvements altermondialistes et des Indignés, en passant par la Révolution espagnole de 1936, mai 68, le mouvement zapatiste, etc.
On trouve là quelques pages sur le syndicalisme révolutionnaire et la Charte d’Amiens (1906) où les auteurs pèchent par omission et anachronisme. Afin de prouver le lien entre libertaires et marxistes, Besancenot et Löwy mettent en avant les personnages de Pierre Monatte et d’Alfred Rosmer. Pourtant, en 1906, tant Rosmer que Monatte sont encore des syndicalistes révolutionnaires anarchistes. Par contre, au début du XXe siècle, il y a effectivement des marxistes qui théorisent le syndicalisme révolutionnaire et il n’en est pas fait mention. En France, ceux-ci se réunissent régulièrement avec les dirigeants de la CGT, autour de Georges Sorel, au domicile et en présence d’Hubert Lagardelle. Avec eux, il y a aussi, Edouard Berth, Robert Michels (4)… Or tant Lagardelle que Michels évolueront ultérieurement vers le fascisme. Voilà quelque chose de gênant, mais autant le savoir. Quant à Sorel, il rejoindra l’Action française vers 1909, accompagné de Berth, pour se rallier au bolchévisme après 1917.
Le marxisme théorisé par Georges Sorel et popularisé au sein du mouvement ouvrier à la Belle Epoque est éminemment hétérodoxe. Sorel avait espéré trouver une science dans la pensée de Marx, mais après l’avoir étudiée dans les textes, il abandonne cette optique pour voir dans le marxisme un mythe utile, par lequel le prolétariat peut « exprimer son grand refus » (5). Bref, ce marxisme-là ne va pas dans le sens des deux auteurs et ils préfèrent sans doute l’occulter.
Une erreur et une faute
Passons maintenant à la deuxième partie intitulée Convergences et conflits. Il est question ici de la Révolution russe de 1917. Par convergences, les auteurs entendent des analyses qui se ressemblent, comme celle de considérer que cette révolution fut à l’origine « un vaste mouvement de masse ». Sous la dénomination de conflits, ils évoquent la répression sanguinaire qu’eurent à subir les anarchistes (et la plupart des militants de gauche avec eux) à partir de 1920 (en fait dès 1918).
Par une gymnastique périlleuse et peu convaincante, Besancenot et Löwy vont plus loin dans la critique du bolchévisme que ce qu’on a l’habitude de dire dans leur milieu, notamment sur l’écrasement de la révolte des marins et de la population de Kronstadt en 1921, massacre qualifié ici d’erreur et de faute. Pourtant, ils essaient de sauver leur maître à penser : Léon Trotsky. L’homme s’est trompé, a fauté en cautionnant la répression qu’il considérait comme une « tragique nécessité », mais il « lègue des outils politiques antibureaucratiques qui permettent de déceler le fait que la contre-révolution stalinienne était déjà à l’oeuvre au moment du soulèvement de Kronstadt ».
Trotsky aurait eu tort dans les faits, mais raison en théorie. Les auteurs tournent en rond, essaient de sauver une doctrine surannée au lieu de commencer ce qu’ils appellent de leurs voeux, soit de « revisiter ce chapitre tumultueux avec un regard critique aussi acéré que possible ». Cela parce qu’ils se mettent a priori des oeillères, notamment en refusant d’« établir une continuité entre les années Lénine et les années Staline ». Or cette continuité existe. C’est sous Lénine (et Trotsky) qu’à commencé la terreur, le « communisme de guerre », les massacres d’ouvriers révoltés, de paysans réduits à la famine par la confiscation de leurs récoltes et de leur bétail, la répression des anarchistes, des socialistes révolutionnaires et des mencheviks… Entre la dictature de Lénine et celle de Staline, il y a une différence d’échelle, de style, pas de nature (6). C’est de 1918 à 1921, dans le contexte d’une effroyable guerre civile, que les principales institutions du régime se mettent en place : « le Parti-Etat avec son monopole du pouvoir (…), la « double administration » des soviets et de l’appareil ; la surveillance universelle de la Tcheka [police politique] ; et enfin, encore à l’état d’esquisse, la planification centrale de l’économie et la collectivisation de l’agriculture » (7).
La faute à la bureaucratie ?
Fidèles à l’oeuvre de Léon Trotsky, les auteurs mettent en avant la bureaucratie pour expliquer le destin de l’Union soviétique. On lit par exemple qu’on « a laissé le loup de la bureaucratie entrer dans la bergerie de la Révolution » (p. 114) ; il est question de « récupération bureaucratique » (p. 117) ; de « bureaucratisme croissant » en 1921 (p. 132). S’agit-il du même type de bureaucratie que celle qui « prend la main sur le monde syndical » partout dans le monde, et ce dès la « Première Guerre mondiale » (p. 196) ?
Cette explication est des plus discutables. Elle s’appuie sur la théorie de Trotsky, pour qui l’échec de la Révolution allemande et l’édification du socialisme dans un seul pays ont permis à une bureaucratie parasite de se développer dans le Parti. Cependant, pour Trotski, cette bureaucratie n’est pas une classe sociale, car les fonctionnaires soviétiques n’ont pas la propriété des moyens de production. Ainsi
l’URSS restait, à ses yeux, un « Etat ouvrier » et une révolution politique devait suffire à liquider la bureaucratie et à instaurer un véritable socialisme. Il n’est pas difficile de dire, au XXIe siècle, que l’histoire ne lui a pas donné raison… Le système « soviétique » a finalement accouché d’une société capitaliste ultralibérale, corrompue et maffieuse.
Pour se maintenir au pouvoir, les bolchéviks développèrent un appareil hiérarchisé (Parti-Etat) et centralisé pour lequel les « soviets » (conseils ouvriers), vidés de leur substance, étaient une courroie de transmission de leur pouvoir oligarchique. Peut-on vraiment traiter de « bureaucrates » les dirigeants soviétiques, au même titre que des professionnels du syndicalisme ou des fonctionnaires en Occident ? Si l’on pense au personnage de Makéev, un dirigeant régional dont Victor Serge offre un portrait saisissant dans son roman, L’affaire Toulaév, on ne peut que répondre par la négative. Villageois pauvre, ancien soldat, c’est son audace guerrière et ses discours enflammés qui le font accéder à de hautes fonctions. Introduit dans un monde d’intrigues, il terminera, comme tant d’autres, dans les purges staliniennes. Rien à voir avec la routine qui caractérise les carrières bureaucratiques sous nos latitudes (8). Progressivement, il est vrai, une administration tatillonne constituée de fonctionnaires et de techniciens se développera en URSS. Toutefois, plus que la formation ou les diplômes, c’est l’allégeance au Parti qui permet à ces « spécialistes » de bénéficier des avantages réservés à la classe élue.
Si l’on en croit Martin Malia, dans les années qui suivent la Révolution d’octobre, les centaines de milliers de recrues du parti bolchévik étaient avant tout des audacieux qui croyaient en leur victoire : idéalistes, aventuriers ou opportunistes… Bref, comme l’écrivait Alexandra Kollontai en 1921, une « population hétérogène » qui se transformait en « classe supérieure » et qui allait imposer sa dictature en lieu et place de la prétendue « dictature du prolétariat » (9).
Mettant le marxisme cul par-dessus tête, Lénine et ses camarades avaient développé la superstructure, l’« avant-garde du prolétariat », c’est-à-dire leur Parti et son idéologie. Il leur manquait l’infrastructure : une industrie capitaliste « parvenue à maturité » avec une classe ouvrière nombreuse ; préalable, à leurs yeux de marxistes, à la réalisation du communisme dans la Russie arriérée. Afin de combler rapidement le retard industriel, ils ne virent pas d’autre procédé que d’exploiter les paysans, de leur extorquer la plus-value par tous les moyens (terreur et famine). Exploitation dont étaient aussi victimes les ouvriers. Seule la nomenklatura, l’élite de du Parti-Etat, vivait dans le luxe. Quand l’Etat devient le patron, il faut parler de capitalisme d’Etat (un concept utilisé y compris par Lénine au début de son règne) et non de « collectivisme » (10) comme le font les deux auteurs. Les héritiers des bolchéviks ont discuté durant des décennies de la politique économique qui aurait dû être mise en oeuvre à l’époque pour réussir, alors que la vraie question est : comment a-t-on pu imaginer qu’il était possible de construire une société juste en recourant à une concentration de tous les pouvoirs au sein du Parti-Etat et au final, dans les mains de son chef ?
Et Marx dans tout ça ?
Le marxisme a été (ou est encore) une religion d’Etat en Union soviétique et dans ses pays satellites, en Chine, à Cuba, en Corée du Nord… Y a-t-il un rapport entre l’oeuvre de Marx et le désastre du prétendu « communisme » tel qu’il a été vécu par des millions de personnes au XXe siècle. Nous ne prétendons pas établir une relation directe, de cause à effet, entre la doctrine marxiste et le Goulag, mais nous pensons qu’il y a un lien et qu’il faut s’interroger sur la nature de ce lien. C’est une question dont les communistes du XXIe siècle ne peuvent faire l’économie. Surtout pas ceux qui se revendiquent de l’oeuvre du philosophe allemand. Nous allons leur donner ici une ou deux pistes.
D’abord, la question de la paysannerie. S’il est un secteur où la politique léniniste puis stalinienne a été délétère, c’est bien celui de l’agriculture. Collectivisation forcée, puis durant les années de la NEP (11) encouragement à l’initiative privée, puis à nouveau collectivisation forcée ont profondément déstructuré les communautés paysannes, décimant ou réduisant en esclavage les habitants des campagnes. Cette haine du paysan n’aurait-elle pas trouvé sa source, ou tout au moins une justification, dans les considérations de Marx sur les paysans français qui, tels « des pommes de terre » dans un sac, auraient été dépourvus de conscience de classe et éloignés du progrès, notamment parce que « leur champ de production, la parcelle, ne permet, dans sa culture, aucune division du travail, aucune application de la science » (12) ?
On se demande aussi pourquoi tant de beaux esprits ont pu soutenir aussi longtemps l’URSS et les pays dit communistes. Bien sûr, il y avait ceux qui croyaient que la cité radieuse se réalisait en Russie
et qui, s’ils s’y rendaient en délégation, étaient prêts à admirer les lieux sélectionnés qu’on voulait bien leur montrer, sans chercher à voir l’envers du décor. Mais il y avait aussi tous ceux qui, imbus de dialectique hégéliano-marxiste, étaient prêts à assumer l’immonde parce qu’ils pensaient qu’il fallait passer par là ; parce que, par une « ruse de la raison », le mal accoucherait du bien. Edgar Morin a décrit ce qui était à l’époque son raisonnement et celui de beaucoup d’autres : « …la soif de conquêtes de Napoléon avait été une ruse de la raison historique pour répandre les idées de la Révolution française en Europe. La domination de la nouvelle caste de l’appareil stalinien en URSS était la ruse de la raison contemporaine pour effectuer la marche en avant du devenir humain » (13).
Questions politiques
La quatrième partie porte le titre de Questions politiques. Là, les auteurs critiquent les anarchistes, notamment parce qu’ils rejettent « le concept marxiste de planification ». Les anarchistes n’iraient pas assez loin dans l’alternative au système capitaliste en mettant en avant les idées d’autogestion ou de collectivisation… Pour Besancenot et Löwy, seule une « planification démocratique » sur une échelle, locale, nationale, continentale et, espèrent-ils, planétaire pourrait répondre aux défis de l’abandon du nucléaire, par exemple. Selon leur conception, la société serait amenée à « choisir démocratiquement les lignes productives à privilégier et le niveau des ressources qui doivent être investies dans l’éducation, la santé ou la culture ». Derrière ces déclarations lénifiantes transparaît toujours cette vision téléologique (marxiste) suivant laquelle le communisme serait l’aboutissement de l’aventure humaine et qu’économie planifiée et socialisme sont une seule et même chose.
Sans être particulièrement pessimistes, nous pensons que dans le monde de demain, plongé dans le tumulte et les désastres dus au réchauffement climatique, aux conflits multiples et à l’effondrement prévisible de notre civilisation… les expériences autogestionnaires, collectivistes ou communistes devront certainement négocier avec d’autres réalités, d’autres formes d’organisation sociale. Quels types d’échanges marchands subsisteront ? Une « planification démocratique » est-elle possible, désirable ? Est-ce que le fait de décider à la majorité plus une voix de l’abandon du nucléaire, de la gratuité des transports publics, de l’interdiction des pesticides ou des OGM… – comme le proposent les auteurs – est une bonne option ? Nous ne le pensons pas. Y compris dans nos organisation, la recherche de majorités donne lieu à des manoeuvres démagogiques et à des manipulations.
Ceux qui vivent dans les parages d’une industrie dangereuse, par exemple, n’ont pas exactement les mêmes intérêts et préoccupations que ceux qui en bénéficient sans (trop) en subir les méfaits. Dans de tels contextes, le vote pour ou contre (sous forme d’un référendum) est susceptible de diviser profondément la collectivité. Alors qu’un processus de négociations et de recherche de consensus, dans le cadre d’une organisation fédéraliste où les différents collectifs sont pris en compte, serait nettement plus fécond.
Quoi qu’il en soit, plus qu’un projet d’organisation politico-économique tel que la planification démocratique, ce sont nos valeurs de liberté, de partage, de solidarité, notre souci de sauvegarde de l’environnement (principe de précaution)… qui doivent nous guider dans l’élaboration et la mise en oeuvre d’une société égalitaire et auto-organisée.
Enfin, Besancenot et Löwy reprochent aux anarchistes leur refus de participer aux élections. Ils affirment que pour les marxistes, les campagnes électorales sont « une occasion rare de présenter leurs analyses et leurs propositions à la masse de la population », que les élus « peuvent utiliser les Parlements (ou conseils municipaux) comme une tribune… ». Ils disent aussi que « dans certains cas, il faut voter pour des candidats de la gauche réformiste, quand c’est le seul moyen de barrer la route à la droite la plus réactionnaire ».
Ce sont des arguments que nous avons entendus des centaines de fois, mais qui ne sont pas convaincants. Il y a un côté jésuite à demander aux gens de voter pour vous, tout en leur disant qu’on ne veut pas prendre le pouvoir et qu’on ne croit pas dans le système. Le parlement comme tribune… mais tout le monde se fiche de ce qui se passe au parlement ! Quant à l’argument que c’est en votant pour des « candidats de la gauche réformiste » qu’on peut faire barrage au fascisme, il est pour le moins fallacieux. Si l’extrême-droite progresse, c’est parce que les élus de gauche ne tiennent pas leurs promesses, sont corrompus, etc. Ce n’est pas dans les urnes qu’on peut faire barrage à la démagogie d’extrême-droite, mais sur le terrain social.
Il faut rappeler aussi que, dans certains cas, une candidature « révolutionnaire » peut contribuer au succès de la droite réactionnaire. En 2002, lors du premier tour de l’élection présidentielle, un certain Olivier Besancenot avait obtenu 4,25% des suffrages, un succès qui a vraisemblablement contribué à l’échec de Lionel Jospin et qui a amené son parti, la LCR, à demander à ses électeurs de « faire barrage au candidat du Front National » Jean-Marie Le Pen, lors du deuxième tour, soit à voter pour un certain Jacques Chirac, qui n’appartenait pas précisément à la « gauche réformiste » !
Bref, en participant au jeu électoral, ces marxistes transmettent un discours brouillé et contradictoire, se brûlent les doigts et vont de concessions en concessions.
Pour conclure
L’affaiblissement du mouvement anarchiste date du début du XXe siècle. Parmi les raisons de ce déclin, le marxisme, puis la Révolution russe, occupent une bonne place.
Avec Marx et ses disciples, le mouvement ouvrier a été amené à croire que le développement industriel était un préalable au progrès de l’humanité ; que le capitalisme accoucherait, tôt ou tard, du communisme dont il était soi-disant porteur. Une « bonne nouvelle » dont nous voyons aujourd’hui les résultats. Quant à l’URSS, elle a offert à des millions de travailleurs exploités, la consolation de croire qu’il existait un pays où régnait leur dictature. Ce grand mensonge, une fois découvert, a désorienté des générations de militantes et militants.
Que des marxistes aient envie de se rapprocher des libertaires, pourquoi pas, mais ils devraient d’abord ôter la poutre qu’ils ont dans l’oeil et porter un regard autrement plus critique sur leur histoire et leur doctrine que celui de Besancenot et Löwy. Se contenter d’injecter un peu d’oxygène prélevé, ça et là, chez les anarchistes pour faire bouger encore un peu le vieux corps marxiste n’est pas une option sérieuse.
Quant aux anars, nous ne pouvons que leur suggérer de ne pas devenir marxistes libertaires. Les questions sans réponse et les contradictions des penseurs anarchistes ou des socialistes que Marx traitait d’utopiques n’ont pas été résolues par la prétendue « science » marxiste. Plutôt que de trébucher toujours sur la même pierre, il est temps d’explorer de nouvelles pistes.
A. Miéville
1. Déjà en février 2003, dans la revue ContreTemps (n°6) Michaël Löwy et Philippe Corcuff, prétendaient renouer le fil rompu entre marxistes et anti-autoritaires au sein de la Première Internationale, en publiant les contributions de différents auteurs trotskystes et libertaires, sous le titre Changer le monde sans prendre le pouvoir ? Nouveaux libertaires, nouveaux communistes. Réagissant à cette initiative, j’avais alors écrit un texte intitulé Quand des Trotskystes veulent devenir libertaires http://direct.perso.ch/contret.html Consulté le 06.10.2014.
2. Paris, Plon, 1974. Sur ce thème, voir Jean-Christophe Angaut, Bakounine à l’ombre de Jacques Duclos, novembre 2011. http ://atelierdecreationlibertaire.com/blogs/bakounine/bakounine-a-lombre-de-jacques-duclos-489/
Consulté le 13.09.2014.
3. Résolutions du Congrès général tenu à La Haye du 2 au 7 septembre 1872, in Jacques Freymond (dir.), La première internationale, Genève, Droz, 1962, Tome II, p. 373.
4. Shlomo Sand L’illusion du politique. Georges Sorel et le débat 1900, Paris, La Découverte, 1984, p. 13 et p. 145.
5. Voir notamment Christophe Prochasson, L’invention du marxisme français in Jean-Jacques Becker et Gilles Candar (dir.), Histoire des gauches en France, Paris, La Découverte, 2004, p. 441.
6. Voir Dimitri Volkogonov, Le vrai Lénine d’après les archives secrètes soviétiques, Paris, Laffont, 1995.
7. Martin Malia, La tragédie soviétique, Paris, Seuil, 1995, p. 187.
8. Par « bureaucrate », on entend en général un travailleur intellectuel qui a accédé à son poste par un système de promotion régulé (formation ou concours) et dont la mission est d’appliquer des procédures correspondant aux normes en vigueur. La principale dysfonction de la bureaucratie étant d’oeuvrer à sa propre survie, indépendamment de son utilité.
9. Alexandra Kollontai, L’opposition ouvrière, cité par Willy Huhn, Trotski le Staline manqué, Paris, Spartacus, 1981, p. 43.
10. Page 163, les auteurs écrivent que la dictature stalinienne a instauré une « version grossière du collectivisme ». Rappelons que par collectivisme, la tradition socialiste entend la propriété collective des moyens de productions, ce qui est très différent de la propriété étatique qui existait en URSS.
11. NEP : Nouvelle politique économique (1921-1928).
12. Karl Marx, Le 18 brumaire de Louis Bonaparte, Paris, La Table Ronde, 2001, p. 300.
13. Edgar Morin, Mes démons, Paris, Stock, 1994, p. 71.